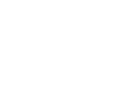Des plantations au succès commercial : l’ascension chocolatée d’Euphrasie Mbamba
Il y a quelque chose de profondément ironique dans le fait de grandir au milieu des plantations de cacao et de ne découvrir le chocolat qu’à quinze ans. Quelque chose qui dit tout de la violence des systèmes économiques mondiaux, de ces frontières invisibles qui séparent ceux qui cultivent de ceux qui transforment, ceux qui produisent de ceux qui savourent. Euphrasie Mbamba, aujourd’hui à la tête de Sigoji, maison de chocolat multiprimée en Belgique, incarne cette fracture et, surtout, sa réparation.
Quand le Cacao Était un Jeu d’Enfance
Euphrasie a passé son enfance dans un village dans la région du centre au Cameroun.
Dans les plantations de son grand-père, le cacao n’était pas une matière première. C’était son terrain de jeu. Les fèves séchées au soleil sur de grandes nattes servaient de pions pour le songo, un jeu de stratégie africain.
« Pour moi, le cacao était plus un jeu qu’autre chose. Je n’avais pas conscience de sa valeur ni du fait que c’était une matière première qu’on transformait ».
Ses journées d’enfant ? Chasser les cochons et les poules qui venaient chiper les précieuses graines. Jouer avec ses cousins. Voir son grand-père partir vendre cette récolte pour acheter de la viande fumée qu’il revendait à son tour. Et protester, avec l’innocence de l’enfance, quand le cacao disparaissait : « Je n’aime pas la viande, je préfère jouer avec le cacao. »
Ce grand-père possédait plusieurs plantations. Il avait dix enfants à nourrir. Pourtant, malgré ses terres et son labeur, il n’a jamais pu gagner honnêtement sa vie. Cette injustice-là, Euphrasie ne la comprendra que bien plus tard, quand elle découvrira le prix du chocolat en Belgique et réalisera l’ampleur du déséquilibre.
La Révélation Belge
À quinze ans, Euphrasie arrive en Belgique. Sa mère, partie « se chercher » en Europe comme tant d’Africains avant elle, a enfin une situation stable et fait venir sa fille unique qu’elle avait laissée aux soins de ses grands-parents. C’est là, dans ce pays qui se targue de son excellence chocolatière au même titre que ses frites et sa bière, qu’ Euphrasie goûte au chocolat pour la première fois.
Mais le véritable choc, ce n’est pas le goût. C’est la découverte du lien.
À dix-huit ans, en terminale, elle comprend enfin : ce chocolat qu’elle mange depuis trois ans provient du cacao avec lequel elle jouait enfant. Ce produit fini, brillant, valorisé, célébré, vient de ces fèves que son grand-père vendait à bas prix. Cette prise de conscience la bouleverse.
« Je savais que mon grand-père avait plusieurs plantations et plusieurs enfants. Je connaissais le prix du chocolat ici, je connaissais l’engouement du chocolat ici, et je me disais : c’est pas normal. »
Pas normal qu’un homme avec autant de terres et de travail n’ait pas pu offrir une vie décente aux siens. Pas normal que le Cameroun, quatrième producteur mondial de cacao, reste invisible dans l’histoire du chocolat. Pas normal que les Africains ne fassent pas le lien entre ce qu’ils cultivent et ce que le monde consomme.
Cette révélation aurait pu devenir un projet immédiat. Mais la vie en décide autrement.
Les Années d’Oubli
À dix-huit ans, Euphrasie veut se former en chocolaterie. On lui dit qu’il est trop tard, qu’il aurait fallu commencer à quinze ans. Sa mère, pragmatique, lui sert une vérité plus brutale encore : « Tu ne peux pas faire ces études, tu es une femme, tu es noire. La plupart des chocolatiers en Belgique sont des hommes blancs. »
Alors Euphrasie devient traductrice. Elle travaille pour des organisations internationales, pour le bureau permanent de l’Union africaine, puis pour la Commission européenne au Centre de développement pour les entreprises. Son travail ? Traduire des documents sur l’agriculture africaine, accompagner des cacaoculteurs, être le pont linguistique entre l’Afrique et l’Europe.
Elle accompagne des experts qui partent en mission en Afrique, facilite les échanges avec les cacaoculteurs qui viennent présenter leurs projets en Europe. « J’étais quand même toujours baignée dans ce monde agro-pastoral. »
Le chocolat, elle n’y pense même plus. Du moins consciemment. Parce qu’en réalité, chaque document traduit, chaque cacaoculteur rencontré, chaque projet de développement lu est un rappel silencieux de cette injustice initiale. Le cacao est là, en filigrane, attendant son heure.
Le Déclic de Wallonie
Le chocolat revient sur le devant de la scène par la porte de l’amour et du pragmatisme. Euphrasie rencontre son mari, quitte Bruxelles pour la Wallonie, arrête les trajets épuisants, devient professeure de langues. Mais elle se rend compte qu’elle n’a « ni la psychologie ni la pédagogie pour être enseignante ».
Puis vient un voyage au Cameroun. Les plantations familiales sont désoeuvrées. Son mari, avec le regard neuf de l’étranger, lui dit cette phrase décisive : « Vous avez une richesse que vous ne développez pas. »
La réponse d’Euphrasie résonne comme un aveu : « C’est ce que j’ai voulu faire quand j’avais 18 ans … »
Son mari réplique avec une simplicité désarmante : « Pourquoi pas maintenant ? »

L’École du Bean-to-Bar
Euphrasie retourne donc aux études, en cours du soir. Mais elle se heurte à une nouvelle désillusion : on lui apprend à faire des pralines avec des pépites de chocolat déjà transformées. Or, ce qu’elle veut, c’est comprendre la transformation totale, de la fève à la tablette. Ce processus que les écoles européennes n’enseignent pas, parce qu’elles partent du principe que le chocolat arrive déjà sous forme de pépites.
« Ce que moi je veux, c’est savoir comment partir de la matière première (cacao) au produit fini. »
Elle quitte l’école après un an. Et fait ce que personne n’attendait d’elle : elle contacte des chocolatiers, non pas comme chocolatière, mais comme cacaocultrice. Elle propose sa matière première. Les grandes maisons ne l’écoutent pas. Mais elle a de la chance : le mouvement « bean-to-bar » émerge. Certains artisans chocolatiers veulent revenir à la fève, comprendre son origine, maîtriser chaque étape de la transformation.
Un chocolatier dit oui. Et c’est le début de tout.
Sigoji : L’Histoire Écrite avec ses Enfants
Le nom lui-même est une archive vivante. Sigoji naît en 2014, presque en même temps que ses deux fils. Ugo, son aîné, a aujourd’hui quatorze ans. Siméo, onze ans. Et Sigoji, la maison, a presque onze ans aussi.
Le « Si » vient de Siméo, parce qu’ Euphrasie était enceinte de lui quand elle a lancé l’entreprise. « Je me dis que c’est peut-être sa grossesse qui m’a donné le courage de me lancer, malgré les doutes. »
« Le « Go » est pour Ugo, qui a grandi en regardant sa maman travailler, qui a dormi sur un matelas dans la chocolaterie à peine âgé de deux ans.
Et le « Ji » ? C’est pour les baies de goji, présentes dans la première praline qu’elle a créée.
« J’espère en tout cas que le chocolat n’a pas volé 10 ans de sa vie », dit-elle en parlant d’Ugo. Une phrase qui résume tout : la culpabilité des mères entrepreneures, le poids du sacrifice, mais aussi la transmission. Hugo n’a pas vécu autrement qu’en voyant sa maman bâtir, créer, résister.

La Révolution Silencieuse du Cacao Camerounais
Parler de Sigoji, c’est aussi parler d’un acte politique déguisé en praline.
Euphrasie a signé des contrats avec l’État camerounais pour payer les cacaoculteurs trois fois le prix du marché.
Elle a travaillé avec les institutions locales et des chocolatiers belges engagés. Elle a contribué à la création des centres d’excellence au Cameroun, pour transformer la perception mondiale de la fève camerounaise.
Il faut comprendre une chose : les fèves du Cameroun, appelées « fèves rouges brique » à cause de la terre rouge caractéristique du pays, ont longtemps été méprisées. La raison ? Dans l’Est du pays, où la pluviométrie est élevée, le manque de soleil oblige à sécher les fèves à la fumée de bois. Résultat : un chocolat fumé, considéré pendant des années comme de mauvaise qualité et vendu à bas coût.
Aujourd’hui le chocolat fumé est apprécié. Les fèves camerounaises sont classées comme cacao d’excellence.
Des cacaoculteurs remportent des prix internationaux. La fève du Cameroun est la seule à avoir naturellement cette couleur chocolat que nous connaissons tous, tandis que d’autres fèves, comme celles de Madagascar par exemple, doivent être colorées pour ne pas perturber le consommateur.
Le cacao camerounais a des notes boisées, fumées, avec ce « côté terre rouge » qui le rend unique.
Grâce au travail d’Euphrasie et d’autres pionniers, il est passé de mal gradé à hautement valorisé. Une revanche silencieuse sur l’histoire du chocolat.
Cette quête de reconnaissance pour une matière première africaine méprisée résonne avec le combat d'Annie Adiogo, qui transforme le niébé camerounais en produits d'excellence grâce à l'innovation technique, prouvant que les trésors alimentaires du continent méritent d'être sublimés.
L’Envers de la Médaille : Quand le Succès Devient un Piège
Mais Euphrasie n’est pas une idéaliste naïve. Elle sait que « cet engagement est un couteau à double tranchant ».
Aujourd’hui, le prix du cacao camerounais a explosé : 5 200 francs CFA le kilo. Tout le monde veut devenir cacaoculteur. Et pendant que le Ghana et la Côte d’Ivoire connaissent des difficultés, le Cameroun se retrouve avec un cacao trop cher pour être compétitif.
Lors de son dernier voyage au Cameroun, Euphrasie est venue avec un message clair : « Attention, c’est un marché fluctuant. »
Le revers de la médaille arrivera dans deux ou trois ans. Soit les cacaoculteurs apprennent à faire des économies, soit ils diversifient leurs cultures, soit la chute sera brutale.
Et puis il y a cette autre menace, celle dont personne ne parle :
« L’Occident peut trouver d’autres alternatives et commencer à faire du chocolat sans cacao. À ce moment-là, qu’est-ce qu’on fait de notre propre matière première si on n’a pas trouvé les moyens nous-mêmes de la transformer sur place ? »
La solution ? Devenir auto-consommateurs. Associer le cacao à d’autres produits africains, ou d’autres types de consommation. Créer une industrie de transformation locale. Cesser d’être seulement des fournisseurs de matière première.
La Fémini-Battante
Quand on demande à Euphrasie comment elle jongle entre sa vie de mère, d’épouse, d’entrepreneure et d’artisane, elle rit : « Moi je n’arrive pas à jeter l’éponge. c’est quelque chose que je n’ai jamais su accepter, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. »
Elle dit toujours oui aux opportunités. Elle dort moins. Elle fait du mieux qu’elle peut.
« Je ne suis pas Wonder Woman, mais je pense qu’il faut dire oui à toutes les opportunités, parce que leur somme fait en sorte qu’on crée quelque chose de positif. »
Elle se définit comme une « fémini-battante », pas féministe. « En tant que femme, on est capable de tout, il n’y a rien qui est impossible, je préfère essayer. »
Son kit de survie ? Trois ingrédients non négociables :
- L’audace pour se lancer
- Le côté aventureux parce que c’est un voyage dont on ne connaît pas la fin
- L’amour pour continuer, car sans passion, tout semble difficile
« Si on dit non parce qu’on a des craintes, on se met des barrières à soi-même. On se conditionne à l’échec sans avoir essayé. Il faut lutter contre ça. »
L’Empire en Construction
Aujourd’hui, Sigoji, c’est une usine en Wallonie, quatre boutiques (trois en Belgique à Ciney, Rochefort et Uccle, et une au Grand-Duché de Luxembourg), quinze salariés, et un palmarès impressionnant : médailles d’argent et de bronze au Salon du Chocolat de Bruxelles en 2016, Meilleure artisane 2017 par La Vitrine de l’Artisan, Prix Gastronomie & Food 2018 par C’est du Belge et Paris-Match, Chocolatière de l’année 2019 en Wallonie et au Luxembourg par le Gault & Millau, et en 2021, le Benelux Award Artisan Chocolatier of the Year pour son excellence en matière de durabilité.
C’est du chocolat qui voyage en Chine, des partenariats en France, notamment dans le Nord. C’est une petite révolution qui se fait une praline à la fois.
Quand on lui demande ce qu’elle veut laisser comme héritage, Euphrasie ne parle pas de chiffres d’affaires ou de nombre de boutiques. Elle dit : « Je rêve qu’un jour tous les petits-enfants du monde mangent du chocolat Sigoji. »
Un rêve d’empire, certes, mais surtout un rêve de réparation. Que les enfants africains connaissent le goût de ce que leurs grands-parents cultivent. Que le lien rompu entre le cacao et le chocolat soit enfin rétabli.
Et si elle a servi d’exemple, tant mieux. « Je considère ma vie comme une aventure. »
Cette histoire de transmission familiale par la nourriture résonne avec celle d'Esther Mpemba, qui a transformé le maquis vibrant de sa mère congolaise en un empire de traiteur afro, prouvant que l'héritage culinaire peut devenir un acte d'entrepreneuriat puissant.

La Leçon du Cacao
Il y a une justice poétique dans le fait qu’une enfant qui jouait avec des fèves de cacao sans savoir ce qu’elles deviendraient soit aujourd’hui celle qui réécrit les règles de l’industrie du chocolat. Euphrasie Mbamba ne se contente pas de faire du chocolat d’excellence. Elle répare une fracture historique, elle reconstruit un pont entre deux continents, elle refuse que son grand-père soit mort sans avoir pu vivre décemment de son travail.
Chaque tablette Sigoji est un témoignage. Une résistance douce contre l’oubli et l’injustice.
Dans un monde où le chocolat est souvent réduit à un produit de plaisir facile, Sigoji ose être plus : un acte de transmission, de dignité, et d’espoir.
Parce qu’au fond, il ne s’agit pas seulement de chocolat. Il s’agit de réparer ce qui a été cassé. De rendre visible ce qui était invisible. De transformer le jeu d’enfance en héritage.
Et ça, c’est une histoire qui mérite d’être savourée lentement, comme un bon chocolat camerounais, aux notes de terre rouge.
Euphrasie n'est pas seule dans son combat. Elle fait partie d'une nouvelle génération de chocolatiers africains qui transforment le cacao directement pour en faire des produits d'exception : d'Axel Emmanuel Gbaou en Côte d'Ivoire à Selassie Atadika au Ghana, en passant par les sœurs Addison et leur marque 57 Chocolate. Ensemble, ils réécrivent l'histoire du chocolat africain, une tablette à la fois.
A Retenir
- Sigoji : maison de chocolat bean-to-bar fondée par Euphrasie Mbamba en 2014
- Engagement : paiement des cacaoculteurs camerounais à 3 fois le prix du marché
- Excellence : fèves rouges cloîtrées du Cameroun, notes boisées et fumées, aujourd’hui reconnues internationalement
- Palmarès :
- 2016 : Médaille d’argent et médaille de bronze au Salon du Chocolat de Bruxelles
- 2017 : « Meilleure artisane » par La Vitrine de l’Artisan (référence nationale SPF Économie)
- 2018 : Prix Gastronomie & Food par C’est du Belge en collaboration avec Paris-Match
- 2019 : Chocolatière de l’année en Wallonie et au Luxembourg par le Gault & Millau
- 2021 : Benelux Award Artisan Chocolatier of the Year & Award for Excellence in Sustainability in Food & Beverage
- Impact : 4 boutiques (Belgique et Luxembourg), 15 salariés, présence internationale (France, Chine)